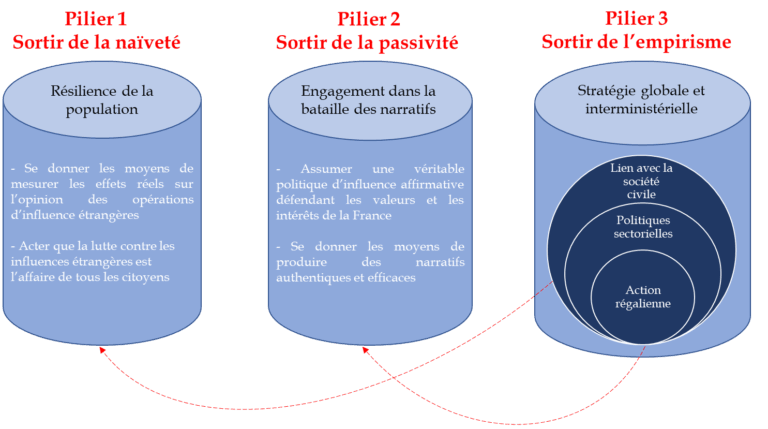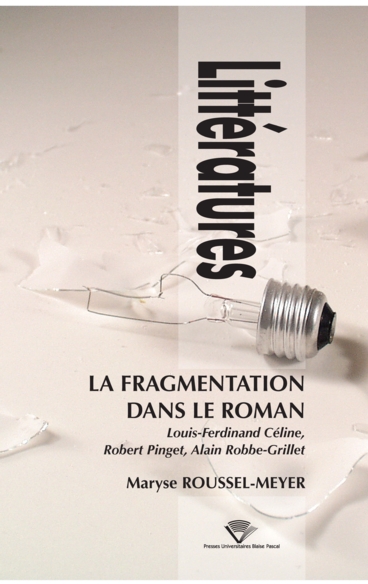Le système d’assurance-chômage a été construit par les syndicats ouvriers et financé par les cotisations des membres. À la fin du XIXe siècle, les organisations sociales-démocrates et chrétiennes avaient des caisses de chômage qui intervenaient auprès du cotisant en cas de perte d’emploi. Mais lors de la crise économique de 1873, ces systèmes ont montré leurs limites. Les pouvoirs publics ont ensuite intervenu dans le financement des caisses, créant ainsi un système de protection contre l’extrême pauvreté et de syndicalisation. L’objectif était d’ renforcer les syndicats. En 1900, la ville de Gand a créé un fonds de chômage, avec une approche différente où les syndicats jouaient le rôle d’intermédiaires, mais il n’était pas obligatoire d’être affilié pour bénéficier de l’allocation. D’autres communes ont tenté de répondre au problème en créant des bourses du travail et des offices de placement. La première intervention de l’État belge a eu lieu en 1907, lorsque le gouvernement a octroyé au ministère du Travail un budget destiné à financer plusieurs caisses de chômage. Les gouvernements, sous l’influence des milieux catholiques conservateurs se sont montrés rétifs à toute idée d’étendre les mécanismes d’assurance-chômage au niveau national.
Au lendemain du premier conflit mondial, le plat pays a traversé une grave crise économique due aux destructions et au transfert de l’équipement industriel vers l’Allemagne. On dénombre alors un million de chômeurs. Le gouvernement d’union nationale a créé en 1920 le Fonds National de Crise (FNC). Celui-ci accorde une aide aux chômeurs lorsque ceux-ci sont arrivés en fin de droit aux allocations dans leur caisse syndicale, ou lorsque cette dernière a épuisé ses fonds. L’Etat vient au secours des chômeurs et des caisses de chômage, essentiellement syndicales. Pour se protéger, les travailleurs vont se syndiquer par milliers, renforçant ainsi le poids des organisations et contribuant à une démocratisation accrue de la société. Ce qui ne plaît guère au patronat…
Dès 1921, ce dernier, alors qu’il ne participe en rien au financement du FNC, prétexte les difficultés budgétaires de l’Etat pour exiger une révision de la réglementation de l’assurance-chômage. La presse de droite lui emboîte le pas en lançant des campagnes contre de supposés « abus » perpétrés par les chômeurs. Le gouvernement finit par céder à ces pressions et revoit la réglementation. L’arrêté royal du 6 septembre 1921 stipule que les chômeurs bénéficiant du Fonds national de crise devront, pour toucher des allocations, se trouver en « état de besoin », notion vague et jamais définie officiellement.
Lors de la grande crise des années 1930, le patronat poursuit sa contre-offensive. Les gouvernements successifs, souvent dans le cadre des pouvoirs spéciaux, adoptent des mesures durcissant les conditions d’accès à l’allocation et réduisant son montant. Ces mesures pénalisent au premier chef des catégories déjà vulnérables : jeunes, travailleurs immigrés et femmes mariées. En août 1935, dans un contexte de xénophobie, un arrêté ministériel détermine le pourcentage d’ouvriers étrangers autorisés à rester dans les mines du Hainaut. Ceux qui sont licenciés et qui ne peuvent trouver du travail dans une autre entreprise sont expulsés. C’est également cette année-là qu’est créé l’Office National de Placement et de Chômage (ONPC), l’ancêtre de l’ONEm. Cette création implique la centralisation de la gestion des interventions publiques en matière de chômage. D’un point de vue de démocratie, c’est problématique car cette centralisation entraîne une diminution de l’influence syndicale sur la gestion de l’argent consacré à l’assurance-chômage. C’est cependant nuancé par le fait que les organes dirigeants de l’ONPC intègrent un nombre égal de représentants patronaux et syndicaux. En 1936 éclate la grande grève générale qui obtient l’annulation de certaines mesures contre les chômeurs aux côtés des premiers congés payés.
Durant la Deuxième Guerre mondiale, des membres de la frange éclairée du patronat et des représentants de la classe ouvrière se rencontrent. Pour la plupart, ils ont siégé à la direction du FNC, puis à celle de l’ONPC. Epaulés par des hauts fonctionnaires, ils élaborent le texte qui servira de base au compromis social d’après-guerre : le Projet d’accord de solidarité sociale. Il est cependant un sujet où un arrangement n’a pu être trouvé : les modalités de versement des allocations de chômage. C’est le gouvernement quadripartite mis en place juste après la Libération qui prend l’initiative. Il adopte l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 sur la mise en place de l’Office National de Sécurité Sociale (ONSS). Dans ce cadre, les assurances sociales facultatives avant l’invasion de 1940 deviennent obligatoires : c’est le cas de l’assurance-maladie et de l’assurance-chômage. Le 26 mai 1945, un arrêté consacre le droit généralisé à des allocations de chômage sans qu’il soit tenu compte de l’éventuel état de besoin du bénéficiaire. Par contre, sa situation familiale et son genre sont pris en compte dans le calcul de l’allocation à laquelle il ou elle a droit. Dès lors, le fonctionnement du système n’a cessé de muter. En 1961, l’ONPC est rebaptisé ONEm (Office National de l’Emploi). En 1971, les distinctions entre homme et femme en matière d’allocations de chômage sont abolies.
C’est également cette année-là que l’administration Richard Nixon décide de déclarer la fin de la convertibilité du dollar en or. Cela entraîne un effondrement du système monétaire international mis en place à Bretton Woods en 1944 et une instabilité chronique. La Belgique, pays d’économie ouverte, y est particulièrement sensible. En octobre 1973 a lieu le premier choc pétrolier qui vient mettre le feu aux poudres. Cette crise accentue un phénomène déjà visible la décennie précédente : la désindustrialisation. Des secteurs comme le textile et la sidérurgie sont particulièrement frappés : entre 1973 et 1979, 80 000 emplois passent à la trappe pour le premier cité et 20 000 pour le second. Si une faible reprise se dessine en 1976, la persistance du chômage et de l’inflation montrent que la crise est bel et bien structurelle. Le nombre de chômeurs passe de 70 000 en 1970 à 350 000 dix ans plus tard. Le patronat saute sur l’occasion pour imposer un glissement dans le discours et les pratiques : alors que depuis 1945, les mots d’ordre étaient le développement national et la justice sociale, ils laissent à présent la place à celui de la compétitivité. S’abattent les délocalisations, les restructurations, les licenciements, l’introduction de nouvelles technologies… pour réduire ce que l’on appelle désormais les « coûts salariaux ». Comme par hasard, les secteurs concernés sont souvent ceux qui étaient des bastions de la combativité ouvrière…
Avec les années 1980 débute la contre-offensive néolibérale. Les gouvernements successifs adoptent des plans d’austérité destinés à bloquer les salaires, conjurer l’inflation et relancer la compétitivité des entreprises. Bref, à organiser un transfert de richesse vers des catégories déjà nanties. Dans ce cadre, les premières exclusions de chômeurs de longue durée ont lieu en 1980 et le statut de cohabitant est instauré l’année suivante, impliquant un montant d’allocation moins élevé que pour un isolé. Peu à peu, sous l’influence du thatchérisme outre-Manche et du reaganisme outre-Atlantique, c’est tout le système de protection sociale mis en place après la Libération qui est accusé de mobiliser trop de ressources et de favoriser la passivité chez certains de ses bénéficiaires. Comme au début des années 1920, des discours politiques et des campagnes de presse stigmatisent les « abus » et les « profiteurs », voire les « assistés ».
C’est dans ce contexte qu’en 2004, sous le gouvernement Verhofstadt II, qu’est lancée la première attaque de grande ampleur. Elle porte le nom « Activation du comportement de recherche d’emploi ». Le principe est le suivant : pour être indemnisés, les chômeurs ne doivent plus seulement être disponibles sur le marché du travail (ne pas refuser d’offre d’emploi, se présenter aux convocations, accepter les formations ou les stages), mais aussi fournir régulièrement les preuves qu’ils « méritent » leur allocation. Le chômeur peut perdre cette dernière s’il ne ramène pas de quoi démontrer que ses efforts sont « suffisants », et ce même si le VDAB, le FOREM ou Actiris ne sont pas capables de lui proposer des offres d’emploi correspondant à son profil. En d’autres termes, on assiste au retour d’une notion très XIXe siècle et très victorienne : celle du pauvre méritant (deserving poor). Cette « activation » est mise en application progressivement par tranches d’âge :
La procédure consiste en trois entretiens espacés de minimum quatre mois (en moyenne huit).
Si, lors du premier entretien, le chômeur est évalué négativement, il doit signer un contrat comportant une liste d’actions à mener obligatoirement. Le deuxième entretient vérifie si ce contrat a bien été respecté. En cas de nouvelle évaluation négative, il y a signature d’un nouveau contrat et une suspension d’allocation de quatre mois. Une évaluation négative au troisième et dernier entretien entraîne l’exclusion définitive.
Si lors du premier entretien, le chômeur est évalué positivement, il est à nouveau convoqué pour un entretien douze ou seize mois plus tard selon les cas.
La mise en place de la procédure entraîne plus qu’un doublement des décisions défavorables aux chômeurs en quatre ans : de 64 303 en 2004, le nombre passe à 131 257 en 2008. Et ce dispositif n’a nullement été remis en cause malgré les effets de la crise des subprimes…
La deuxième grande offensive a été lancée en 2011-2012 sous le gouvernement Di Rupo. Elle est entrée en vigueur en 2015. elle a consisté à s’attaquer aux allocations d’insertion, c’est-à-dire aux allocations perçues par les gens qui n’ont pas droit aux indemnités de chômage sur base de leur travail et les obtiennent par défaut sur base de leurs études. Ces allocations d’insertion ont été limitées à trois ans. En outre, le gouvernement Di Rupo a renforcé la dégressivité dans le temps des allocations de chômage complet. après 17 à 48 mois d’indemnisation, selon son passé professionnel, le chômeur se retrouve au forfait, ce qui signifie qu’il reçoit un montant minimum (1437 euros bruts par mois pour un isolé et 745 euros pour un cohabitant).
Vient enfin la troisième – et la plus violente – des attaques : celle du gouvernement « Arizona ». La limitation dans le temps des allocations de chômage est prônée depuis longtemps par l’OCDE, le FMI et les organisations patronales. La mesure est défendue de longue date par la N-VA. Avec l’ascension de la tendance Georges-Louis Bouchez, ce credo a été repris par le MR. Depuis 2023, cette mesure est également prônée par le CD&V, les Engagés et Vooruit. Soit les cinq partis qui suite aux élections du 9 juin 2024 se sont mis d’accord pour former la nouvelle coalition gouvernementale.
La limitation dans le temps des allocations de chômage a été votée le 18 juillet 2025 et est parue au Moniteur le 29. Le droit aux allocations de chômage complet est désormais limité à deux ans au maximum, avec une période de base de douze mois, à laquelle pourra s’ajouter une période de jusqu’à douze mois supplémentaires en fonction du passé professionnel. Le droit aux allocations d’insertion est quant à lui limité à un an maximum – et non plus trois.
Cela va entraîner une vague d’exclusions qui va concerner pour l’année prochaine plus de 184 000 personnes. Cette vague est divisée en plusieurs phases :
Durant ces trois premières phases, environ 115 000 personnes perdront leur droit aux allocations. A partir du 1er juillet 2026 démarreront de nouvelles phases d’exclusions successives qui concerneront environ 70 000 demandeurs d’emploi. Un point à noter : ceux dénommés par l’ONEm « chômeurs longue durée » sont souvent des travailleurs précaires, enchaînant intérims, contrats à durée déterminée et temps partiels. Or, pour sortir de la catégorie « demandeur d’emploi », il faut avoir travaillé au moins trois mois à temps plein. Cela veut dire que nombre d’exclus sont des gens qui en fait travaill…
Les partisans de la limitation dans le temps des allocations prennent comme exemples les voisins de la Belgique : France, Pays-Bas, Allemagne… ils oublient de préciser que ces pays ont un système d’aide sociale organisé au niveau national pour les chômeurs en fin de droit. Chez nous, les CPAS (Centres Publics d’Action Sociale) devront prendre le relais. Or, ils dépendent des communes et la loi communale est une prérogative des Régions, flamande, bruxelloise et wallonne. Ce qui veut dire qu’il y a régionalisation au moins partielle de l’aide sociale. La N-VA n’a décidément pas renoncé à son agenda confédéraliste ! On ne peut en effet nier qu’il y a une dimension communautaire au problème car il reste plus difficile de trouver un emploi à Bruxelles et dans la partie francophone du pays. De surcroît, les communes les plus pauvres sont celles qui ont le plus de « chômeurs longue durée », le plus de personnes à charge de leur CPAS et le moins de recettes fiscales. Elles devront se débrouiller et mettre fin à des services non obligatoires (aide aux familles, repas à domicile, maisons de repos, ramassage des encombrants…). Tout cela constitue des atteintes graves à la solidarité nationale.
En outre, le gouvernement n’entend pas s’arrêter là. David Clarinval (ministre MR de l’Emploi) a déjà déclaré qu’il allait donner des coups de burin dans le droit du travail. Avec l’allocation de chômage, le patronat est obligé d’offrir aux travailleurs des salaires et des conditions de travail un minimum convenables. Une fois cette allocation limitée dans le temps, il s’attaquera inévitablement à ceux-ci.
Il faut aussi souligner que cette agression contre une conquête sociale historique est d’inspiration idéologique. Le président du MR Bouchez n’a-t-il pas déclaré qu’il fallait une Margaret Thatcher aux commandes du plat pays ? Il n’y a pas que de l’outrance dans ces propos, mais aussi une certaine vision du monde. De plus, l’économie impliquée par la limitation de l’allocation de chômage dans le temps sera dérisoire. L’assurance-chômage ne représente que 9 % du budget annuel de la Sécurité Sociale (environ 5 milliards d’euros). Par contre, depuis 2005, les cotisations patronales à celle-ci ne cessent de diminuer : cela constitue un manque à gagner de 17 milliards d’euros pour la seule année 2023.
Enfin, ne serait-ce que pour des raisons écologiques, le système économique va devoir faire l’objet de mutations de grande ampleur. Beaucoup de secteurs vont devoir être restructurés, voire passer à la trappe. Nombre de gens vont devoir se reconvertir, d’où la nécessité d’une assurance chômage forte. Dans le documentaire La sociologie est un sport de combat, Pierre Bourdieu affirmait que les attaques des dominants contre les droits sociaux n’étaient pas seulement de la méchanceté, mais aussi de la bêtise. La Belgique va assister à une impressionnante démonstration en la matière…