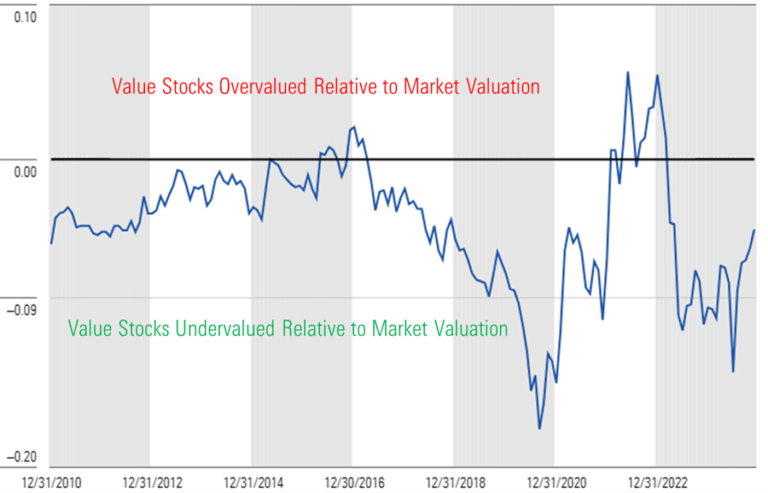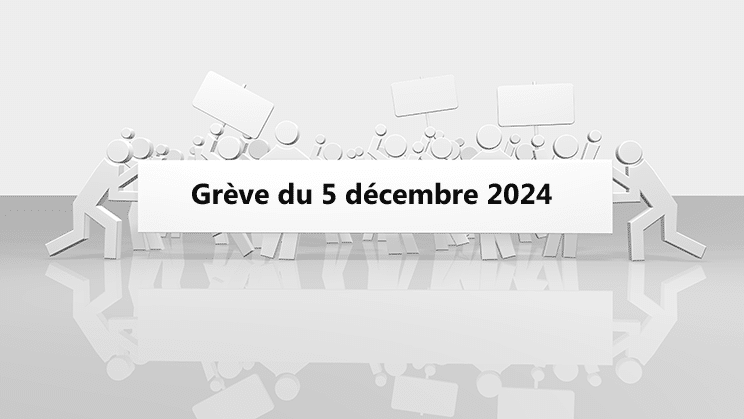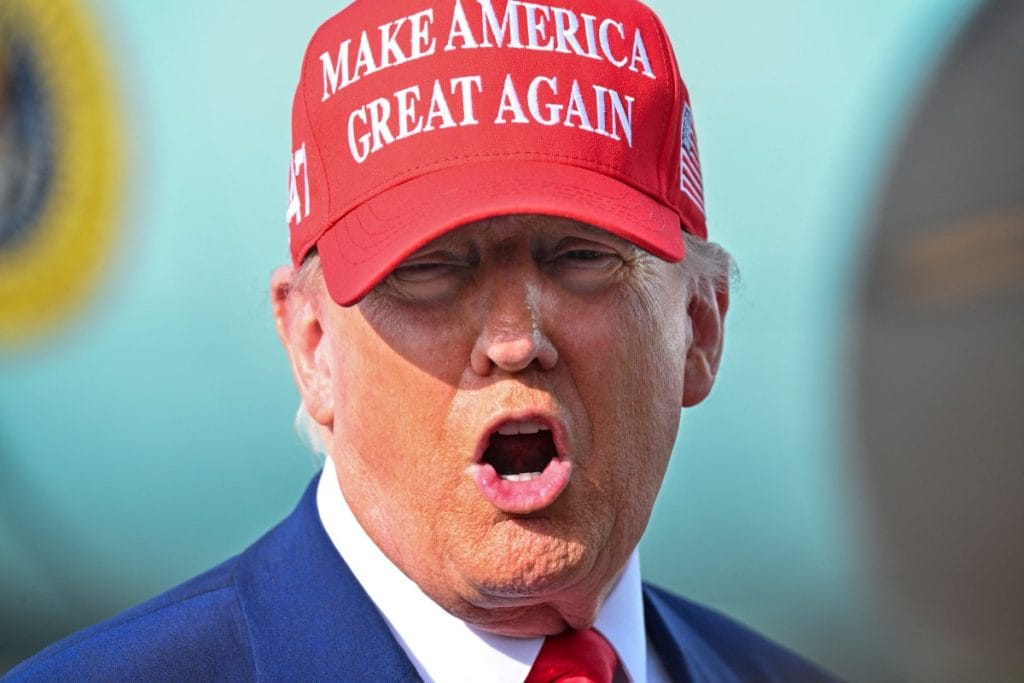
Les États-Unis rejettent la mondialisation qu’ils avaient initiée
Date: 19 février 2025
La mondialisation, une doctrine économique et politique que les États-Unis ont largement promue depuis le milieu des années 1980, est aujourd’hui remise en question par le pays lui-même. Cette transformation radicale dans la perspective américaine reflète un profond changement d’orientation qui affecte l’économie mondiale.
Cinquante ans après avoir contribué à définir les règles du jeu global et à encourager des pratiques de commerce libre et ouvert, les États-Unis s’engagent désormais dans une politique qui va à l’encontre de leurs précédents engagements. Les discours sur la démondialisation et le re-shoring gagnent en popularité, signant ainsi la fin d’une ère marquée par un libre-échange ininterrompu.
L’émergence récente des économies émergentes comme la Chine a remis en question l’hégémonie économique américaine. Le modèle de mondialisation néolibéral, qui était censé favoriser les intérêts américains et subordonner les autres pays, a été contourné par le succès spectaculaire de la Chine. En effet, ce dernier est passé des rôles de sous-traitant à celui d’économie dominante, menaçant ainsi l’ascendant économique historique des États-Unis.
La crise financière mondiale de 2008 a également sonné un premier avertissement sur les risques inhérents à la mondialisation. Elle a révélé que même une économie aussi puissante et intégrée qu’aux États-Unis n’était pas à l’abri des effets déstabilisateurs de cette approche économique globalisée.
La pandémie du COVID-19 et les tensions géopolitiques avec la Russie ont accentué ce sentiment en mettant en lumière les vulnérabilités inhérentes aux chaînes d’approvisionnement mondialisées. La nécessité de souveraineté économique, notamment dans le domaine des biens essentiels et des ressources stratégiques, a été plus que jamais mise à l’avant-plan.
En réponse à ces défis, les États-Unis ont adopté une posture protectionniste, cherchant à ramener la production et les emplois sur leur territoire. C’est un tournant majeur pour une économie qui a longtemps prôné l’idée que la mondialisation était synonyme de progrès économique.
Malgré cette évolution significative dans la politique américaine, il est encore incertain comment le monde se redéfinira sans les principes fondamentaux de la mondialisation néolibérale. La montée des blocs économiques régionaux et l’apparition d’un ordre mondial multipolaire semblent inévitable, mais ces changements pourraient entraver la croissance économique et le commerce internationaux à long terme.
La période actuelle pourrait bien marquer une transition vers un nouvel équilibre géopolitique et économique. Alors que les États-Unis cherchent à réduire leur dépendance aux autres nations, l’émergence d’une nouvelle forme de mondialisation est en cours, qui ne serait pas basée sur le libéralisme économique dominant des dernières décennies.
Cette évolution pourrait mener à une redéfinition radicale de la manière dont les États-Unis et le monde conçoivent l’économie globale. Les prochaines années révéleront si cette nouvelle dynamique est durable ou si elle constitue simplement un interlude avant un retour vers des normes économiques plus traditionnellement libérales.
Samir Saul, docteur d’État en histoire de Paris et professeur à l’Université de Montréal, ainsi que Michel Seymour, philosophe et professeur émérite au même établissement, ont analysé ces changements dans un récent article pour Investig’Action. Les deux auteurs insistent sur la nécessité d’une réflexion approfondie concernant l’avenir de l’économie mondiale en période de transition.
Le monde se trouve à un tournant majeur où les anciennes certitudes sont remises en question et où le futur reste incertain. Les États-Unis ont délaissé la mondialisation qui avait été leur bébé, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère économique et politique inconnue.