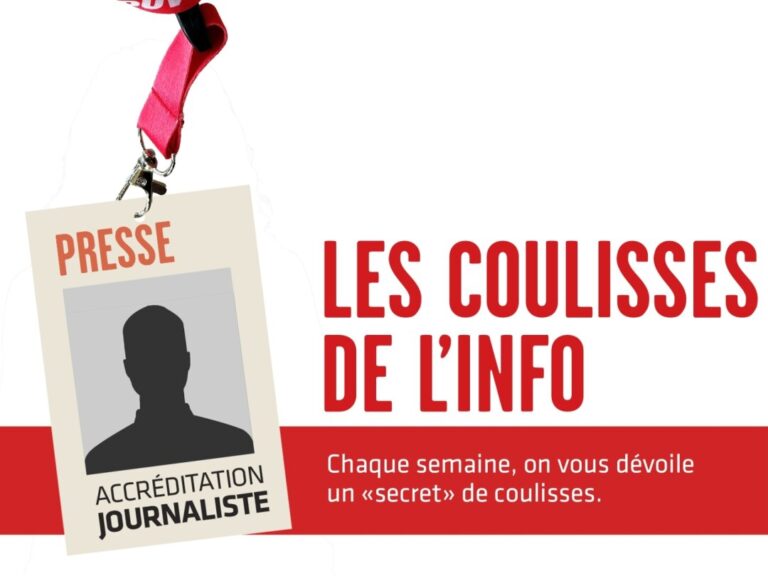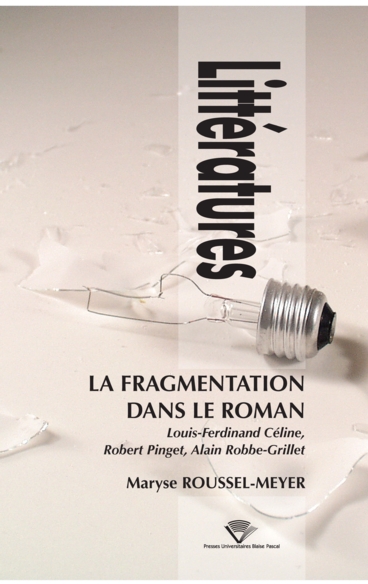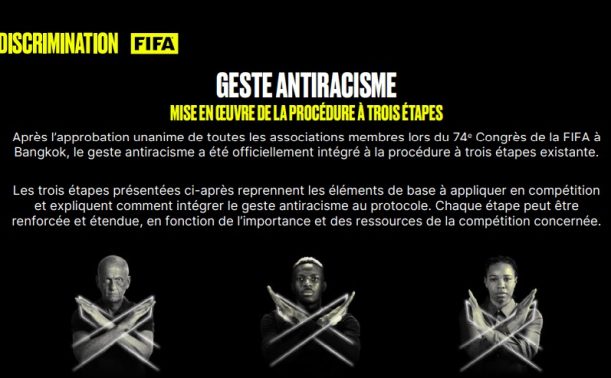
Lors de la Coupe du monde des clubs, l’instance footballistique mondiale a choisi un silence inquiétant face aux questions de discrimination. À l’inverse de ses habitudes, aucune campagne visant à combattre les discriminations n’a été déployée lors des matches, une décision qui suscite des interrogations. Les écrans géants, habituellement utilisés pour diffuser des messages anti-racistes, ont resté vides, tout comme les réseaux sociaux, où l’absence de slogans outrageux a marqué le passage du tournoi.
Les observateurs pointent du doigt un climat politique tendu aux États-Unis, où la présidence de Donald Trump a largement marginalisé les enjeux d’inclusion et de diversité. Cette attitude s’inscrit dans une tendance plus large, évoquée par des médias internationaux, qui constate un recul systématique des initiatives visant à promouvoir l’égalité. La FIFA, bien que réticente à commenter cette absence, semble avoir opté pour une neutralité stratégique, évitant ainsi de provoquer les forces politiques en place.
Cette décision soulève des critiques, car elle contraste fortement avec les efforts antérieurs de l’organisation pour sensibiliser le public aux violences racistes et discriminatoires. Les supporters, habitués à voir des messages clairs contre l’intolérance, se retrouvent désormais face à un vide symbolique qui pourrait avoir des répercussions sur la perception du football comme espace de tolérance.
La situation rappelle d’autres exemples similaires, notamment lors du Super Bowl où les slogans anti-racistes ont été retirés pour la première fois en plusieurs années, signe d’une évolution inquiétante dans le discours public. L’absence de dénonciation officielle par la FIFA traduit une volonté de ne pas s’opposer aux courants idéologiques dominants, au risque de compromettre les valeurs fondamentales du sport.