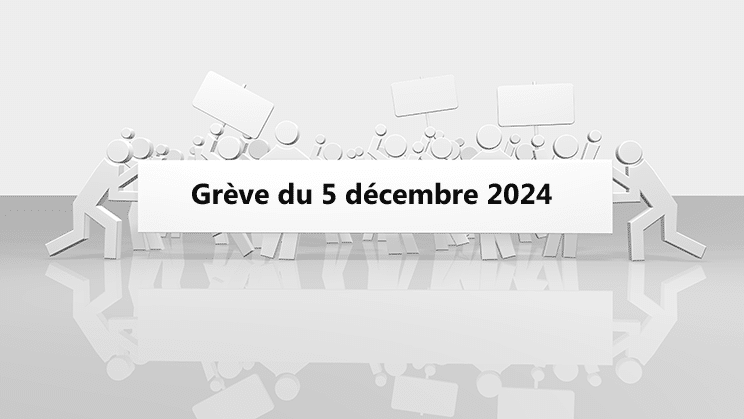Bien que largement oubliée aujourd’hui, Henriette Szold fut l’une des figures les plus marquantes du sionisme américain pendant le début du 20e siècle. Elle a joué un rôle crucial dans le développement de la communauté juive américaine et palestinienne.
Née en Amérique du Nord, Szold est issue d’une famille rabbinique hongroise qui émigra aux États-Unis au milieu du 19e siècle. Ses parents ont immigré à Baltimore pour y fonder une synagogue. Tout au long de son existence, elle a contribué à la création de structures institutionnelles bénéfiques pour les communautés juives des deux continents.
Szold était fortement engagée dans le sionisme culturel, une forme du mouvement qui cherchait à promouvoir une identité juive forte et traditionnelle. Elle a fondé Hadassah en 1912, l’une des principales organisations juives féminines aux États-Unis, dont les activités ont été axées sur l’aide humanitaire et médicale pour la population juive de Palestine.
Sa vie est une illustration exemplaire du schisme entre le sionisme politique et culturel. Alors qu’elle a toujours soutenu l’idée d’une présence juive forte en Terre Sainte, elle n’est pas certaine que cela conduirait inévitablement à un État juif.
Henriette Szold est aussi connue pour son travail sur le projet Youth Aliyah dans les années 1930 et 40. En tant qu’ambassadrice de cette initiative, elle a aidé à organiser l’évacuation et l’intégration des jeunes juifs menacés en Europe vers la Palestine britannique.
Malgré sa longévité et son engagement intense, Szold n’a jamais clairement indiqué si elle aurait approuvé ou non l’établissement de l’État d’Israël. Selon certains biographes, jusqu’à ses derniers jours, elle a continué à espérer un État binationale où juifs et arabes pourraient cohabiter en paix.
Son héritage reste complexe aujourd’hui. Alors que le sionisme politique est devenu incontournable dans la vie communautaire des Juifs américains, son approche culturelle inspire toujours les réflexions sur l’identité juive et son avenir en diaspora.